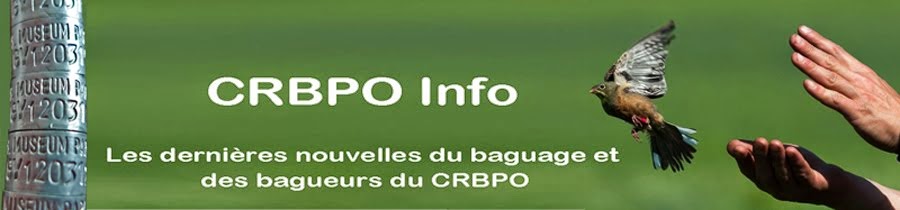|
| Degrés de connectivité migratoire (Fattorini et al. 2023) | | |
Les oiseaux d'une population reproductrice migratrice peuvent hiverner "groupés" (c'est à dire majoritairement dans une même aire d'hivernage restreinte) ou "dispersés" (répartis sur une très large aire d'hivernage). Mesurer cette dispersion hivernale relativement aux localisations en reproduction revient à mesurer la 'connectivité migratoire' (autrement dit, la corrélation spatiale entre les positions en reproduction et en hivernage des oiseaux).
Grâce à la collection unique de données de mouvements d'oiseaux assemblée par EURING pour produire l'Atlas de la migration des Oiseaux en Europe-Afrique (voir post dédié), Fattorini et al. (2023) ont pu mener un caractérisation sans précédent du degré de connectivité de 83 espèces d'oiseaux européens.
La connectivité migratoire ('regroupement hivernal') apparait comme la norme, principalement du fait que les populations sont dispersées sur de larges aires géographiques. Les coûts de la migration conduisent à minimiser les distances de migration, et donc à ce que les oiseaux de différentes régions de reproduction migrent vers des régions d'hivernage au plus proche. La distance de migration moyenne par espèce ressort comme le principal déterminant du degré de connectivité migratoire: plus les aires de reproduction et d'hivernage sont proches, moins il y a de mélange, et donc plus la connectivité migratoire est élevée. Sur le même principe, plus l'aire d'hivernage est restreinte, plus la connectivité est élevée. Les autres caractéristiques biologiques ou phylogénétiques des espèces expliquent peu les différences de connectivité migratoire entre espèce, rappelant la forte labilité du comportement migratoire (les conditions écologiques rencontrées par les populations reproductrices sont plus influentes que les propriétés moyennes des espèces).
Cette compréhension approfondie de la connectivité migratoire est importante pour la conservation: plus la connectivité migratoire est forte, plus la majorité des individus d'une espèce sont dépendants de conditions spécifiques, géographiquement localisées, tant sur leurs aires de reproduction et d'hivernage. Plus une espèce est regroupée sur une aire restreinte, plus nous sommes en capacité d'agir sur la préservation de ses habitats. Plus elle est dispersée, moins il est possible d'avoir une action ciblée, mais également moins il y a de risque d'une exposition de l'ensemble de l'espèce à des menaces fortes et localisées ("tous les oeufs ne sont pas mis dans le même panier").
Cette étude a été possible grâce à l'ensemble des données de baguage collectées sur le siècle passé au travers de l'Europe et l'Afrique, collectées majoritairement par les bagueur.se.s bénévoles et citoyen.ne.s transmettant leurs observations d'oiseaux bagués. Pour la France, le CRBPO transmet ces données annuellement à la base de données européenne (EURING Data Bank), source de cette étude.
Pour en savoir plus:
Fattorini, N., Costanzo, A., Romano, A., Rubolini, D., Baillie, S., Bairlein, F., Spina, F., & Ambrosini, R. (2023). Eco-evolutionary drivers of avian migratory connectivity. Ecology Letters 26: 1095-1107.
Rédacteur: Pierre-Yves Henry