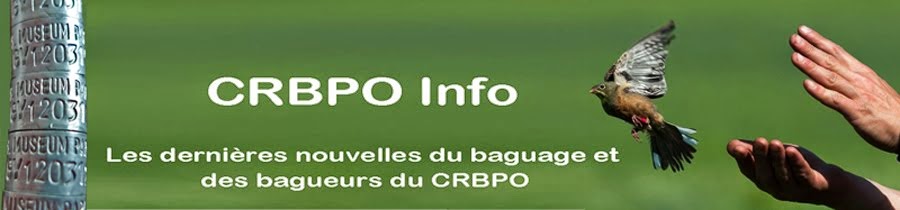En raison de la dégradation de ses habitats de nidification, de migration et d’hivernage, le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) est le passereau le plus menacé d’Europe. D’après les suivis par baguage menés en Europe, la quasi-totalité de la population mondiale transite par la France (Tanneberger & Kubacka, 2018). Le Phragmite aquatique profite des zones humides du littoral Manche-Atlantique pour constituer ses réserves de graisse afin de poursuivre sa migration jusqu’en Afrique de l’Ouest. Du fait de ses nombreuses zones humides, les Pays de la Loire possèdent des sites de halte essentiels à la migration du Phragmite aquatique. C’est pourquoi dans le cadre du Plan National d’Actions, plusieurs stations de baguage ont été mises en place sur la région afin de définir les principaux sites de halte et de savoir comment l’espèce les utilise. Le consortium des partenaires concernés a produit un rapport complet sur ces suivis (Laigneau et al. 2022).
Entre 2008 et 2020, 33 sites de baguages ont mis en place le protocole ACROLA (parfois pour une unique saison) en Pays de la Loire dont une très grande majorité (21) en Loire-Atlantique en raison du complexe de zones humides important : Brière/Loire/Grand-Lieu. A noter que 7 stations se trouvent à plus de 60 km de la côte (Figure 1).
Figure 1 : Localisation des stations de baguage ACROLA en Pays de la Loire
Entre 2008 et 2020, de juillet à septembre, sur l’ensemble des protocoles inscrits au Programme National de Recherches sur les Oiseaux par le baguage (PNRO), 4 006 Phragmites aquatiques ont été capturés en Pays de la Loire (hors données privées de programmes personnels). Ces captures représentent 3 481 baguages (87%) et 525 contrôles (13%). Le protocole ACROLA a permis de réaliser 2 882 captures, représentant 72% des données de l’espèce cible sur l’ensemble des protocoles. En moyenne, entre 2008 et 2020, les Pays de la Loire représentent 50% des données de Phragmite aquatique réalisées en France en protocole ACROLA (Figure 2).
Figure 2 : Nombre de captures de Phragmite aquatique en France (- - -), en Pays de la Loire (
Une analyse complémentaire permet également de tirer une conclusion beaucoup plus inquiétante à l’échelle des Pays de la Loire: les résultats montrent une baisse significative du nombre de captures de Phragmites aquatiques de -70% entre 2008 et 2020 pour l’effectif total, avec un taux annuel de -5,8 % (Figure 3). Cette tendance est également significative pour les jeunes avec une diminution de -60,7% (taux annuel de -5,1%) et pour les adultes avec une diminution de -86,2% (taux annuel de -7,2%) entre 2008 et 2020.
Figure 3 : Effectifs moyens annuels (100m/jour) de baguage de Phragmite aquatique en Pays de la Loire (± SE). Effectif total (courbe noire), effectif jeunes (histogramme gris), effectif adultes (histogramme blanc).
Les analyses se sont également concentrées sur
l’engraissement des oiseaux dans la région. En moyenne, les adultes
s’engraissent de 0,31g/jour (±0,04
SE) et les jeunes de 0,18 g/jour (±0,04
SE) aussi bien en début qu’en fin saison de migration peu importe leur
condition corporelle à leur arrivée sur le site de halte. Ce résultat indique
que la région des Pays de la Loire est ciblée pour l’engraissement et donc que
les individus choisissent de s’y arrêter pour la qualité de ses sites de haltes
(Figure 4 et 5).
Figure 4 : Relation entre FDR (Fuel Deposition Rate) et date de première capture (toutes années et toutes stations confondues).
Figure 5 : Relation entre FDR (Fuel Deposition Rate) et IBMI (Initial Body Mass Index), toutes années et stations confondues.
La durée de halte moyenne du Phragmite aquatique estimée par CMR est de 6,9 jours (IC95% : 3,5-15,6) en Pays de Loire. Cette durée est très proche de celle obtenue par la même méthode dans une étude réalisée dans l’estuaire de la Loire (6 jours) et d’une autre étude menée dans l’estuaire de la Gironde (6,46 ± 0,46 jours).
L’analyse des paramètres étudiés a également permis de discriminer certaines stations dans la qualité des habitats et dans leur utilisation par l’espèce. Les données ont permis de montrer des évolutions d’effectifs similaires entre des groupes de stations et à l’inverse une évolution négativement corrélée entre l’une des stations, à l’intérieur des terres, et les autres sites, proches du littoral.
Les stations des Pays de la Loire fonctionnent comme un complexe de sites dépendant les uns des autres, et offrant des particularités différentes. Certaines stations présentent un passage de Phragmites aquatiques en grand nombre pendant que d’autres montrent une utilisation marquée par des individus expérimentés ayant sélectionné l’habitat de halte pour ses ressources alimentaires. Malgré des différences marquées entre les stations, des échanges sont effectués entre les stations des Pays de la Loire mais également avec des stations hors région et à l’étranger en zone de reproduction et en zone d’hivernage. Ainsi, les efforts devraient porter davantage sur le soutien des stations historiques et des stations accueillant des effectifs importants de sorte à assurer leur pérennité et à maintenir leur rôle de sites d’escale pour le Phragmite aquatique.