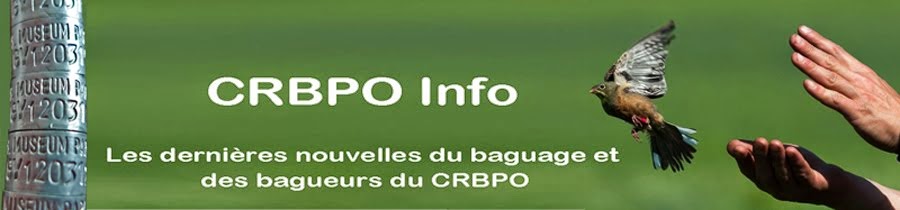Vous l’avez peut-être remarqué sur le terrain : alors que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes lors de la formation au baguage, elles ne représentent plus que 5 % des bagueur(se)s généralistes qualifié(e)s. D’où vient un tel écart ?
Pour la première fois, une enquête sociologique se penche sur la question. Dans le cadre d’un stage de Master 2, Lilou Buchet a mené un travail de fonds, basé sur des entretiens, des observations de terrain et un questionnaire en ligne, qui a recueilli 570 réponses auprès de la communauté (bagueuses, bagueurs, aides-bagueuses et aides-bagueurs).
Son rapport, intitulé « Les inégalités de genre dans le baguage d’oiseaux : causes, effets, leviers », met en lumière une combinaison de facteurs : héritage d’un milieu historiquement masculin, sentiment d’illégitimité plus marqué chez les femmes, manque d’encouragement durant la formation (voir la figure ci-dessous) ou encore difficultés rencontrées lors de la vie en station.
Figure : Répartition des réponses à la question “Avez-vous été activement encouragé.e à passer la qualification ?” par genre
Pour découvrir l’analyse complète et les préconisations, nous vous invitons à consulter le rapport en intégralité (PDF).
Cette enquête a été menée par Lilou Buchet, diplômée de l’EHESS en sciences sociales, parcours Études environnementales.
Elle a été accompagnée par Manon Ghislain, écologue à Patrinat, bagueuse, à l’initiative de l’étude, Benoît Fontaine, écologue à l’OFB CESCO, bagueur, Alexandra Villarroel Parada, directrice du programme Sciences participatives au MNHN, Fanny Guillet, sociologue au CNRS CESCO.
L’étude a été financée par Patrinat et par le programme de soutien interne aux stages du MNHN. Nous les en remercions.
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées dans le cadre de l’enquête, pour l’accueil chaleureux en station, le temps accordé en entretien, le temps passé à remplir le questionnaire, ainsi que les ressources mises à disposition ; votre participation a été une aide inestimable.